Construire une expertise partagée sur les potentialités de restauration écologique des fonds meubles durs profonds du golfe du Lion
Résumé du projet
La façade méditerranéenne française, et en particulier le golfe du Lion, fait aujourd’hui face à une triple transition : énergétique, avec le développement des parcs d’éoliennes marines flottantes, écologique, avec les obligations croissantes de restauration des milieux naturels dégradés, issues notamment du nouveau règlement européen sur la restauration de la nature (en mer 30% des habitats dégradés restaurés en 2030), sociales avec les recompositions des flottes, armements et métiers sous l’effet soit des mesures de gestion soit des mutations liées aux co-activités.
Dans ce contexte, la pêche professionnelle est confrontée à une recomposition de ses zones d’activité, avec l’émergence de nouvelles zones d’exclusion liées aux infrastructures énergétiques (éolien, hydrogène), au développement d’aires marine protégées incluant une ambition spatiale majeure et inédite de zones de protection forte (ZPF), mais aussi à des opportunités inédites de contribution à la restauration des écosystèmes marins, à travers des projets portés en lien avec les aménageurs.
Un projet de restauration écologique doit démontrer qu’il cible un habitat dégradé, documenté scientifiquement ou par des savoirs empiriques, et contribue à restaurer les fonctions écologiques et biologiques de l’habitat ciblé
L’ambition du projet RESTOR est ainsi de construire une expertise partagée sur les potentialités de restauration écologique des fonds meubles durs profonds du golfe du Lion, en proposant :
- une expertise réaliste sur les approches et capacités écosystémiques d’une restauration écologique de ces habitats et milieux : en s’appuyant sur les connaissances empiriques des habitats halieutiques des professionnels de la mer, et sur l’analyse des données géologiques et historiques des fonds et des habitats marins,
- une expertise réaliste sur les difficultés et opportunités en termes politiques d’une restauration écologique de ces milieux : leviers et freins technico-économiques, de gouvernances, d’acceptabilité, etc.
Le projet RESTOR propose ainsi de préciser les conditions de faisabilité d’une restauration écologique au profit direct des ressources halieutiques, crédible, opérationnelle, et potentiellement éligible à des mesures de compensation (séquence ERC) ou à des financements issus des politiques de la biodiversité : fonds européens ou nationaux « Stratégie Nationale Biodiversité », restauration volontaire, crédits biodiversité/Carbone bleu….
Il s’agit aussi de repositionner la pêche comme acteur légitime et moteur de la restauration des milieux marins, dans une logique de coexistence et de co-bénéfices avec les zones de transition énergétique et les aires marines protégées existantes et à venir, pour concrétiser des approches de co-gestion de la biodiversité et de la ressource, dont la pêche est dépendante à 100%.
Objectifs
Sur le plan écologique, la démarche de RESTOR s’inscrit dans une logique de restauration fonctionnelle plutôt que de restauration strictement structurelle ou historique. Le concept de restauration implique normalement le retour à un état écologique antérieur, avec ses fonctions et structures originelles. Toutefois, dans les contextes fortement anthropisés comme le golfe du Lion, RESTOR propose de s’attacher à une réhabilitation écologique ou un renforcement d’habitats par ingénierie écologique, notamment lorsqu’il s’agit de recréer des substrats durs bio-inspirés sur des fonds meubles ou partiellement dégradés. RESTOR se positionne donc à l’interface entre science, écologie appliquée et gestion intégrée, en assumant une approche réaliste, fondée sur les fonctions écologiques à restaurer (refuge, reproduction, alimentation) plutôt que sur une reproduction à l’identique des habitats passés.
Sur le plan technique et politique, la démarche de RESTOR s’attache à lever les résistances identifiées autour de la restauration écologique en mer : juridiques et techniques (réversibilité, suivi, contrôle, occupation du domaine public, etc.), sociaux (acceptabilité, distributivité de l’effort et des gains), politique (planification spatiale intégrée).
Ainsi, RESTOR vise à élaborer une expertise pluridisciplinaire visant à identifier et caractériser les zones et fonds marins dégradés et leur potentiel de gain écologique sur le plateau du golfe du Lion au croisement des différentes politiques publiques sectorielles et de leurs objectifs et contraintes pour une restauration écologique crédible. Les substrats durs, où la productivité écologique et halieutique est la plus importante, seront ciblés en priorité. Comme il s’agit de restauration écologique le but est de rétablir des écosystèmes équivalents au niveau de l’habitat, des fonctions et des espèces cibles.
- Identifier des zones historiquement riches en habitats structurants aujourd’hui dégradés
- Évaluer le potentiel écologique, halieutique et technique de restauration de ces zones
- Définir les conditions de faisabilité techniques et politiques
- Produire une expertise consolidée et argumentée (document technique en vue de futurs appels à projets de restauration écologique marine)
- Positionner le monde de la pêche comme un acteur reconnu et actif de cette gouvernance.
Méthodologie
Étape 1 : Inventaire des habitats de substrats durs dégradés
- Enquête auprès des pêcheurs (Grau du Roi, Sète, Agde, Port la Nouvelle)
- Analyse des données sur les fonds marins (cartes géologiques anciennes et récentes)
- Collecte d’échantillons iconographiques (plongée, ROV, données IFREMER, relevés de pêche…)
Étape 2 : Évaluation du potentiel de restauration
- Adaptation de la méthode d’évaluation des gains de biodiversité par la restauration « MERCI*»
- Détermination des unités perdues et surfaces potentiellement restaurables
- Identification des espèces halieutiques cibles à fort intérêt, de conservation et/ou sous pression.
- Identification des contraintes et opportunités techniques, politiques et sociales par secteur.
Étape 3 : Approche de génie écologique et conception biomimétique
- Analyse du substrat d’origine, des fonctions écologiques, habitats et espèces associés
- Propositions de design pour des structures éco-conçues
- Co-construction avec les pêcheurs des critères de succès halieutique pour la gestion à long termes des sites de restauration retenus (pérenniser les gains de biodiversité)
Étape 4 : Évaluation technico-économique, Coût de conception, fabrication, pose et suivi
- Estimation de la valeur écologique et halieutique ajoutée
- Scénarios de financement : compensation (ERC), crédits biodiversité, Nature Positive Impact avec les projets de parcs éoliens marins
Étape 5 : Analyse réglementaire et gouvernance
- Cadre d’immersion dans zones sous AOT / parcs d’éoliennes
- Modalités de reconnaissance comme mesures compensatoires (proximité géographique, fonctionnelle et écologique)
*La méthodologie « MERCI » en mer, pour « Méthode pour Eviter Réduire et Compenser les Impacts », préconisée par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD, juin 2021), permet d’évaluer de manière standardisée les gains de biodiversité d’une action de restauration en comparant un état avant/après restauration, à l’aide d’indicateurs rapides (RAM). Elle est utilisée notamment dans les démarches de compensation écologique (Pioch et al., 2018). Un programme est en cours pour l’adapter à la méditerranée, pilotée par la Région Occitanie, la DIRM, l’OFB avec l’université de Montpellier Paul Valéry et réalisé par Eco-Med et Creocean (bureaux d’études environnement) les résultats sont attendus en fin 2025 et une application pour RESTOR est déjà validée.
Statut du projet
Prévu : 01/11/2025 - 31/10/2026
Zone
Golfe du Lion
Porteur du projet
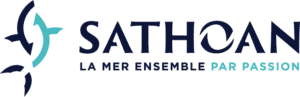
Partenaire

Financeur


